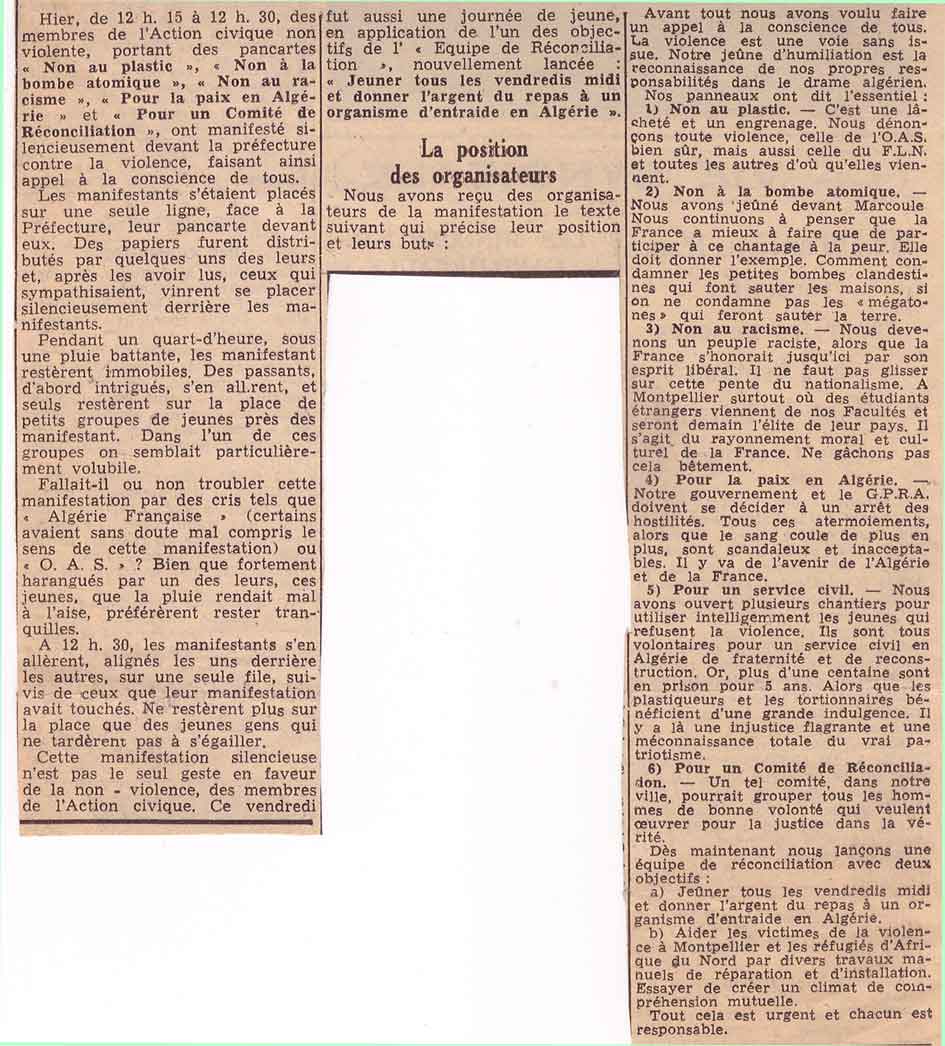Quelque temps après les retrouvailles des anciens de l’ACNV en 2003, Pascal Gouget nous fait parvenir ses souvenirs rassemblés en novembre 2004.
|
Je n’ai connu Jean-Louis Gauthier que pendant les quatre années durant lesquelles nous avons milité dans le groupe montpelliérain de l’ACNV. 
Suzanne et Pascal Gouget lors de notre rencontre de 2009
Il a rejoint ce groupe vers décembre 1961 ou peu avant. Il avait alors 31 ans. Ingénieur agronome, il travaillait à Montpellier comme contrôleur à la protection des végétaux. Chrétien convaincu, élevé dans la religion protestante, il se sentait concerné par les malheurs des humbles, des rejetés de la société ; il visitait les prisonniers, travaillait avec un organisme d’aide aux prostituées. Il fut témoin du drame du Vercors dans son enfance et de celui d’Algérie comme officier de réserve. Dès son engagement dans le groupe local de l’ACNV, il en fut un des membres les plus fidèles et les plus actifs. Par solidarité avec les objecteurs non-violents, il renvoya, en même temps que moi, son livret militaire en mars 1962 à l’occasion du procès de Claude Voron. Le 20 mai 1963, nous fûmes l’un et l’autre condamnés à huit jours de prison avec sursis après un procès d’une haute tenue, avec des témoins de qualité en faveur des accusés (le pasteur Chapal, le pasteur Exbrayat, le professeur Kahane, le père Cardonnel, Jean Lagrave, Bernard de Cazenove). – M. Lavy insiste sur la bonté conciliatrice de M. Gauthier. – Le pasteur Chapal parle de sa famille accueillante, de ses engagements pour soulager les malheureux, de tous les débats de conscience que pose le service militaire obligatoire. Voir leur procès à la date du 20 mai 1963 Pour persister dans notre action, nous avons refusé de payer les frais de justice inhérents au procès : voir la lettre de Jean-Louis ci-dessous. J’ai envoyé la mienne le 26. Ce refus n’eut pas de suite. |
Montpellier le 22.10.63
Monsieur le Percepteur,
J’ai l’honneur de vous faire savoir que je n’ai pas l’intention de payer le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance le 27 mai 1965.
Ce n’est pas pour me soustraire aux exigences de la loi : je me reconnais coupable devant elle.
En m’exposant d’abord au jugement et maintenant à la contrainte par corps, c’est contre la loi que je veux agir. En effet, je pense que la loi constitue en elle-même un crime puisqu’elle oblige chaque citoyen à apprendre à tuer. Si ceux qui s’y opposent refusaient de prendre leur part des charges publiques, ils seraient absolument condamnables, mais ce n’est pas le cas : ils réclament la parité devant le danger avec les militaires pour le temps de guerre à la condition que ce soit pour l’accomplissement d’un travail constructif et demandent à être exposés au danger en temps de paix. Ce n’est pas la peur du danger qui les mine mais la peur de faire du mal, la crainte de détruire des foyers et des biens , la crainte de « saper la maison qu’ils habitent ».
Dans ces conditions, mon refus de payer m’expose à la contrainte par corps par laquelle je veux prolonger mon action en montrant ma solidarité totale avec ceux qui ont subi ou subissent encore plusieurs années d’emprisonnement pour vouloir construire la justice et la paix.
Vous comprendrez, Monsieur le Percepteur, que ce n’est pas pour vous créer des « tracasseries » que j’agis ainsi, mais parce que la situation faite aux objecteurs de conscience est anormale.
Veuillez agréer, Monsieur le Percepteur, mes salutations distinguées.
|
La dernière action de notre groupe d’ACNV n’est pas liée à la demande d’un service civil mais à un problème montpelliérain. Le 12 novembre 1963, à la suite d’une grosse manifestation viticole, dix-neuf personnes sont matraquées et arrêtées par la police pour jets de pierre et le lendemain neuf d’entre elles sont condamnées en correctionnel à des peines allant de 15 jours à 4 mois de prison, peines confirmées en appel en décembre 1963. Beaucoup de Montpelliérains sont convaincus que ces personnes ont été arrêtés au hasard et que leur culpabilité ne repose que sur la parole des policiers. Les condamnations prononcées sont désavouées par une grande partie de l’opinion publique locale qui pense que des innocents ont été condamnés pour l’exemple. Un comité montpelliérain de Défense des libertés se crée, il groupe trente-cinq partis, syndicats, associations viticoles, mouvements de jeunes. L’ACNV n’en fait pas partie, car ce comité ne retient pas l’éventualité d’une action non-violente, mais fait seulement appel à un meeting. Janvier-février 1964. Le malaise persiste à Montpellier, les manifestations publiques sont interdites (sauf le carnaval !), certains craignent des explosions de violence. Après que Jean-Louis Gauthier a consulté de nombreuses organisations, le groupe montpelliérain de l’ACNV décide d’une manifestation publique silencieuse pour briser cette crainte d’exprimer publiquement une opinion et pour demander que soit révisé le procès. Jean-Louis a été l’agent moteur de cette action ; le groupe l’a suivi et j’ai assumé avec lui les responsabilités. La manifestation est décidée pour le mardi 17 mars 1964. Elle est interdite, puis tolérée. Un désaccord sur la durée de la manifestation silencieuse (annoncée pour 15 minutes et interrompue après 5 minutes) fait que quarante-neuf manifestants sont chargés dans les voitures de police et emmenés au commissariat. Au bout d’une heure, les manifestants sont libérés, excepté Gauthier et moi-même qui sommes inculpés « d’embarras sur la voie publique ». (Voir, plus bas, la manifestation racontée par Jean-Louis.) Le 23 mars, nous sommes condamnés chacun à 8 jours de prison ferme en audience de flagrant délit. Témoins : M. Balan, professeur de philosophie au lycée, le pasteur Chapal, le père Cardonnel, dominicain, le pasteur Crespy, professeur à la faculté de théologie. Nous faisons appel le 24 mars, nous sortons de prison le mercredi 25. A l’occasion de ce procès, plus de 70 témoignages écrits sont adressés au juge. Extraits : – Professeur Cotte, de l’Ecole nationale supérieure agronomique : – Mme M. Michel : – Mme A. Meynard, professeur de lettres au lycée du Mas de Tesse : « Prendre au sérieux ce qui arrive aux autres, comme s’il s’agissait de nous-même, n’est-ce pas le principe de toute vie sociale valable ? Monsieur Gauthier n’est pas de ces gens que les désagréments des autres laissent dormir tranquillement. Il a trop de droiture pour ne pas sentir quel poids représenterait, pour un honnête homme, une condamnation injustifiée. Il croit trop profondément au prix inestimable d’une seule personne humaine pour se résigner à laisser oublier un verdict suspecté de hâte. » Ce même 23 mars, le comité de Défense des libertés a organisé, avec le professeur Boulet, [1] un meeting de solidarité et de protestation qui a réuni 1500 personnes dont plusieurs centaines ont accompagné une délégation à la préfecture. Après un long stationnement massif, la manifestation s’est terminée sur les cris de « Vive la liberté et vive la justice ! ». En appel, le 27 mai 1964, la peine est confirmée et augmentée de 500 F d’amende pour chacun. Le juge ne nous a pas permis de lire les textes que nous avions préparés. Nous avons dû improviser notre défense sans pouvoir exposer les motifs de notre action, le président du tribunal ne posant qu’une question : la manifestation était-elle interdite ou non. Nos avocats ont fait de leur mieux et les textes ont été versés au dossier. Ce texte de Jean-Louis est donc un inédit ! (Les notes sont de Pascal Gouget.) |
|
Texte préparé par Jean-Louis Gauthier en vue du procès en appel le 27 mai 1964. J’ai fait appel, Monsieur le Président, pour les deux raisons suivantes : la vérité et l’intérêt. La plus importante des deux est la vérité qui, comme vous allez le voir, n’a pas triomphé lors du procès en flagrant délit. La seconde est l’intérêt que je porte à avoir un casier judiciaire vierge. Je serai très bref. Je parlerai très succinctement des raisons qui nous ont poussé à une action dans la rue et à la préparation à cette action. Les raisons qui nous ont poussé à l’action sont publiquement connues. C’est la croyance, très généralement répandue à Montpellier, que des innocents ont été condamnés en novembre et décembre 1963. Sans accuser personne, notre pensée étant que toute l’affaire pourrait résider dans une cascade de fautes mineures aboutissant à un état de fait grave. Nous demandons, en payant de notre personne, et en nous efforçant de ne faire tort à aucune autre, à ce que le problème créé par les condamnations soit traité. Nous trouvons très grave cette conviction si largement répandue, qu’il y a eu une injustice. Fondée ou non, cette conviction sert et peut servir de justification à des actions revendicatives ou, si les circonstances s’y prêtent, à des déchaînements de violence. Des paroles fortes, des jugements très violents – je ne les ai pas adoptés – mettant en cause les CRS, les magistrats et le régime m’ont obligé à agir. Ils m’ont fait craindre que, au nom de la justice et de la liberté, des crimes se commettent dont les premières victimes seraient évidemment des CRS et éventuellement des magistrats. La préparation de cette action s’est faite en consultant des personnes représentant les tendances les plus diverses afin qu’aucun aspect de la question ne nous échappe. De simples conversations ont été suivies de visites où nous soumettions à la critique un texte qui était corrigé par l’interlocuteur lui-même. Ce texte est devenu un document polycopié appelé « Suggestion pour une manifestation ». Tous les groupements que j’ai pu rencontrer ont été sollicités. Les encouragements individuels étaient la règle générale sans qu’aucun groupement ait pu envisager de se dire non-violent au nom de ses adhérents. La manifestation s’est finalement décidée le 10 mars. Toute la période qui a suivi, jusqu’à 17 heures le 17 mars où nous avons eu l’accord de la préfecture, a été très éprouvante pour moi. Deux perspectives opposées alternaient d’heure en heure. Ou nous serions très peu nombreux et nous risquerions d’être ridiculement enlevés avant d’avoir pu rassembler les manifestants, ou nous serions très nombreux et cela pouvait être le drame avec des bagarres, des blessés, et peut-être comme on ne manquait pas de nous le dire, des morts. Le jeudi 12 mars, dans l’après-midi, les premiers tracts sont prêts. J’en donne quelques paquets à quelques amis. Le vendredi 13 à 9 heures, la première personne à qui j’en donne un à titre individuel est M. le commissaire principal Salles. Il essaie de me dissuader puis il m’introduit chez M. le commissaire central auquel je réexpose le projet. Aucun tract n’est encore distribué. Les commissaires ont employé tant d’arguments que j’ai eu un moment d’hésitation. La ville est calme, sauf quelques étudiants « dangereux ». La semaine suivante est très chargée : procès des viticulteurs le 17, grèves le 18, carnaval étudiant le 20. On nous conseille de retarder de quelques semaines, etc. Le samedi 14, nous sommes convoqués au commissariat de 9 h à 9 h 30. Les plus sévères avertissements nous sont donnés. La distribution de tracts peut justifier notre arrestation : si la manifestation n’a pas lieu nous prenons le risque de faire de 2 à 6 mois de prison, si la distribution des tracts aboutit à un attroupement, nous pouvons encourir de 1 mois à 1 an de prison. Nous aurions pu nous arrêter là. Mais nous avions la certitude absolue que notre devoir était de manifester quoi qu’il puisse en coûter. Un dernier signe nous soutenait : plus de 10 000 tracts avaient été déposés en 24 heures dans les boîtes aux lettres. Des amis qui n’avaient pour la plupart aucune appartenance politique naissaient en grand nombre. A la lecture du tract, on approuvait : aussi nous avons pensé que si nous n’arrivions pas à manifester il fallait au moins que Montpellier sache ce que nous avions voulu faire. C’est pourquoi la distribution a continué, les distributeurs étant avertis qu’ils pouvaient se faire arrêter et faire arrêter les signataires du tract, Gouget et moi. Le lundi 16 mars, nous apprenons par le commissaire que le mandat d’arrêt n’est pas rédigé mais qu’il pourrait l’être bientôt. Constatant que notre demande d’audience adressée à M. le Préfet n’a pas eu l’effet escompté, que le souci exprimé par l’arrêté de M. le Préfet est aussi le nôtre de ne pas faire courir de danger à la population, considérant que les hommes dont le principal souci est le bien public devraient pouvoir s’entendre, nous tentons une ultime démarche. Nous rédigeons des articles pour la presse et une lettre pour M. le Préfet. Les articles n’ont pas paru, mais la lettre est au dossier. C’est avec cette lettre en main, lettre qui lui a été remise par M. le Préfet, que M. le commissaire central discute avec M. Gouget le mardi à 16 heures dans la cour du palais de justice. A la même heure, je rentre à la maison. J’apprends alors que M. Gouget est parti avec un commissaire et que M. le chef de cabinet m’a fait demander. Je pense que nous serons retenus au minimum jusqu’à 20 heures. Je me prépare à subir le même sort et je téléphone à la préfecture où l’on me dit que l’on ignore tout de M. Gouget. Je téléphone au commissariat où l’on me demande simplement si on peut me rappeler. Quelques instants plus tard, le commissaire me fait dire que M. Gouget n’est pas arrêté comme je le crois et qu’il vient me voir avec lui. Je suis prêt à toute éventualité. M. le commissaire arrive et m’apprend que la manifestation aura lieu presque comme prévu : nous partirons de la Tour de la Babotte, nous marcherons selon le trajet prévu dans notre demande et nous nous arrêterons quand un barrage de gardiens de la paix nous barrera la route. Ces dispositions ont reçu l’accord de la préfecture. De telles nouvelles après des jours et des nuits d’angoisse, après plusieurs jours de jeûne [2] me rendent fou de joie. Je ne m’attendais pas à cela ; je croyais être arrêté, et voilà que nous somme autorisés à manifester. En effet, la manifestation commence comme prévu. Une voiture radio occupée par des agents de police surveille le rassemblement : elle est stationnée entre le Marché Rond et le feu rouge. Elle rend compte de nos évolutions. Ainsi nous apprenons que les fourgons ont quitté la Comédie et qu’on les a vus vers le boulevard Louis-Blanc. A 18 h 15, nous commençons à nous rassembler. Peu après 18 h 50, je prends la parole et j’annonce que nous ferons 15 minutes de silence si nous sommes interceptés. A 18 h 15, 20 minutes après le début du rassemblement, nous prenons l’ordre de marche. Nous marchons 2 par 2, je suis en tête. Nous gênons les piétons sur le trottoir alors que la rue est presque vide, aussi je dévie naturellement vers la chaussée sans constater le moindre ralentissement de la circulation. Nous marchons très lentement. A 18 h 45, nous sommes près de la rue des Balances quand un cordon de gardiens de la paix barre toute la chaussée obligeant les voitures à emprunter la rue Marceau. Nous nous arrêtons. Les fourgons sont bientôt là. Nos banderoles nous sont enlevées. M. le commissaire nous accorde 5 minutes de silence mais je me suis privé de la possibilité d’en discuter puisque j’en ai annoncé 15 sous la Tour de la Babotte. Tout le drame est là : notre accord avait été mal discuté sur ce point. M. le commissaire se rapproche des voitures radio et revient en nous demandant de passer sur le trottoir. Je regarde les trottoirs, ils sont couverts de monde. Si j’avais su ce qui a suivi, j’aurais demandé au public de nous céder sa place et nous nous serions mis sur le trottoir en bon ordre et je ne serais pas aujourd’hui devant vous. [3] Mais j’ai refusé. Les fourgons n’ont eu aucune peine à se ranger le long de la file des manifestants assis, laissant leurs abords de part et d’autres suffisamment dégagés pour que les gardiens de la paix aient la place d’évoluer, si bien que nous sommes embarqués à 49 en moins de 4 minutes et que nous terminons notre quart d’heure de silence au commissariat. Il ne me reste qu’une chose à ajouter : alors que vers 20 heures nous allions, Gouget et moi, rejoindre nos épouses et nos amis, l’ordre de garder tous les manifestants et d’établir une notice sur le organisateurs est arrivée au commissariat. M. le commissaire, qui est par ailleurs le chef de la sûreté, dut établir la notice sur laquelle doit paraître le motif d’inculpation. Je me vois encore dans son bureau alors qu’il feuilletait le Code pénal à la recherche du bon motif d’inculpation et qu’il bougonnait pour lui-même, je cite : « Ce n’était pas une manifestation interdite ». Je me permets d’insister. Ce n’était pas n’importe quel commissaire, ce n’était pas le commissaire de service mais c’était le chef de la sûreté lui-même chargé de l’application de l’arrêté interdisant notre manifestation. Il connaissait très bien l’affaire puisque nous en avions parlé souvent ; une demi-heure le jeudi 12 mars ; une heure le vendredi 13 ; le 14, il m’avait attendu plus d’une heure devant chez moi pour me signifier l’interdiction. La mardi 17, à 9 heures, j’étais encore allé le voir pour savoir s’il n’y avait rien de nouveau quant à l’interdiction et je lui avais en même temps annoncé que nous serions peu nombreux puisque les journaux n’avaient pas fait paraître nos articles. Le mardi 17, vers 15 heures, Monsieur le Préfet lui avait remis notre lettre afin qu’il prenne avec nous les mesures qui permettraient de prévenir d’éventuels incidents. Après quelques hésitations entre divers motifs d’inculpation, M. le commissaire écrivait sur la notice « embarras de la voie publique ». Le 18 mars au matin, à la fin d’une première nuit de prison, je pensais qu’il était impossible que nous soyions condamnés puisque M. le Préfet avait mis au point avec nous les modalités pratiques de notre manifestation, et je ne pensais pas être enfermé autrement que par suite d’une erreur. Je m’amusais beaucoup à penser qu’en toute équité nous devrions être trois en prison, Gouget et moi bien sûr, mais Monsieur le Préfet lui-même, sauf le respect que je dois à l’autorité. Mais cela eut bien mal récompensé la compréhension dont nous avions bénéficié : par son geste Monsieur le Préfet n’avait-il pas voulu reconnaître notre souci de l’intérêt général ? Voilà quinze ans, Monsieur le Président, que je m’efforce de ne pas déformer la vérité ni par mes paroles ni par mon attitude. Cela est très difficile : je l’ai constaté une fois de plus le 23 mars. Vous voudrez bien convenir avec moi que, si le 23, j’avais mis les faits en lumière comme je viens de le faire, j’aurais dû être relaxé. C’est pourquoi, afin qu’il ne subsiste pas d’erreur, je désire ardemment que vous me demandiez des précisions ainsi qu’à Monsieur Gouget lui-même puisque nous sommes les seuls à avoir vécu l’affaire . |
|
|
|
Parmi les nombreuses manifestations à Montpellier : |